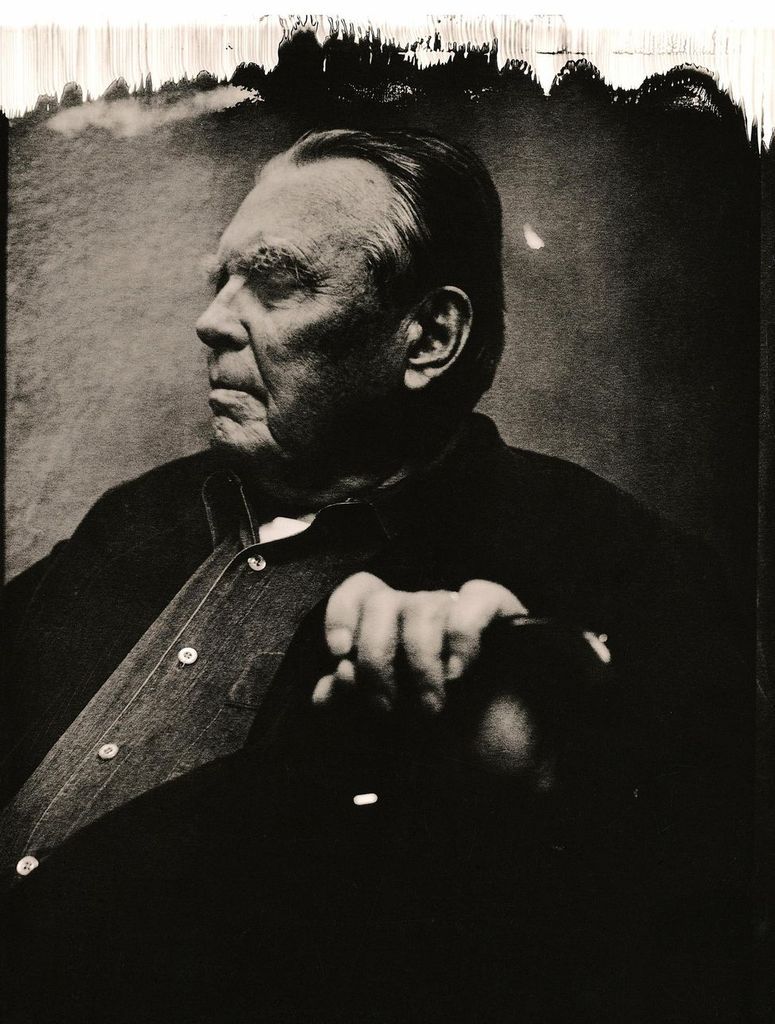John Donne s'est endormi et tout dort autour de lui,
John Donne s'est endormi et tout dort autour de lui,
dorment les murs, le plancher, le lit, les tableaux
dorment la table, les tapis, les verrous, le cadenas,
l'armoire toute entière, le buffet, les bougies, les rideaux.
Tout dort. Les bouteilles, les verres, les vases,
le pain, le couteau de cuisine, la porcelaine, les cristaux,
la vaisselle, la veilleuse, le linge, la commode, les vitres,
l'horloge, les marches, les portes. Partout c'est la nuit.
Partout il fait nuit : dans les coins, dans les yeux, dans le linge,
dans les dossiers, dans le bureau, dans le discours préparé,
dans ses mots, dans les bûches, dans les pinces à charbon,
dans le recoin de la cheminée éteinte et dans toute chose.
Dans les vestes, dans les souliers, dans les bas et dans les ombres,
derrière le miroir, dans le lit, sur le dos de la chaise,
dans le vase encore, dans le crucifix, dans les draps
dans le balai près de l'entrée, dans les pantoufles. tout s'est endormi.
Tout dort. La fenêtre. Et la neige à la fenêtre.
La pente blanche du toit voisin, et la nappe
qui le couronne. Tout le quartier gît dans le sommeil,
mortellement écartelé par le rectangle de la fenêtre.
Les arcades, les murs, les fenêtres, tout s'est endormi.
Les pavés de pierre et de bois, les croisées, les parterres.
Les clôtures, les chaînes, les dorures, les bornes.
Aucune lumière ne s'allume dans la nuit, aucune roue ne grince...
Dorment les portes, les anneaux, les poignées, les cadenas,
les serrures, les verrous et leurs clefs, les barres de fer.
Aucun bruit, aucun murmure, aucun chuchotement,
le seul crissement de la neige. Tout dort. L'aube s'enfuit.
Dorment les prisons, les serrures. Dorment les balances
sur les étals des poissonniers. Dort le porc éventré.
Les maisons, les arrière-cours, dorment les chiens enchaînés,
dorment les chats dans les caves et leurs oreilles dressées.
Dorment les souris et les hommes. Londres dort à poings fermés.
Un voilier dort dans le port, et sous sa coque
l'eau et la neige sifflent, les yeux clos,
et se confondent au loin avec le ciel assoupi.
John Donne s'est endormi, et la mer avec lui,
et la falaise de craie qui domine la mer.
L'île entière dort, emportée dans un sommeil unique
et chaque jardin fermé à triple tour. Dorment
les érables, les pins, les crabes, les mélèzes, les bouleaux,
dorment les versants des monts, les ruisseaux et les sentiers.
Les renards et les loups. L'ours grimpe dans sa tanière.
La neige s'entasse à l'entrée des terriers.
Les oiseaux s'endorment et leur chant se tait.
Le cri des corbeaux, le rire des hiboux dans la nuit,
tout s'efface. L'espace anglais dort dans la paix.
Une étoile étincelle. Un rat vient demander pardon.
Tout s'est endormi. Gisent tranquilles dans leurs tombeaux
tous les morts. Et dans leurs lits les vivants
dorment au milieu d'un océan de chemise.
Ils dorment à poings fermés. Solitaires. Enlacés.
Tout s'est endormi. Dorment les rivières, les montagnes, les forêts.
Les fauves, les oiseaux, le monde des morts et celui des vivants.
Seule la neige blanche tourbillonne du haut des cieux noirs,
où tout dort au-dessus de nos têtes.
Les anges dorment. Les saints endormis oublient
l'angoisse du monde, pour leur honte sainte,
dorment la Géhenne et le paradis dans sa splendeur.
Chacun se cloître dans sa demeure,
Le Seigneur s'est endormi. La terre lui est étrangère.
Ses yeux ne voient plus, ses oreilles n'entendent plus.
Le Diable même dort, et la haine s'est endormie
avec lui sur la neige dans la campagne anglaise.
Les cavaliers dorment. L'Archange et sa trompette dorment.
Leurs chevaux dorment et se balancent en rêve.
La foule innombrable des chérubins enlacés
dort sous la voûte de l'église Saint-Paul. John Donne
s'est endormi. La poésie est plongée dans le sommeil.
Dorment toutes les images, toutes les rimes
et les accents. Les vices, le spleen et les péchés
tranquilles, gisent épars dans leurs syllabes.
Et chaque vers chuchote à l'autre, comme un frère,
un ami à son meilleur ami : pousse-toi donc un peu.
Mais ils sont tous si loin des portes du paradis,
ils sont si pauvres, si drus, si purs, qu'ils sont unanimes.
Toutes les strophes dorment, dort le choeur sévère des iambes,
dorment les chorées, comme des gardes le long d'un défilé.
Et dort en eux la vision des eaux noires du Léthé.
Et derrière eux la gloire dort à poings fermés,
à poings fermés dorment les malheurs et les souffrances.
Dorment les vices dans l'étreinte du bien et du mal.
Dorment les prophètes. La neige qui tombe, blanchâtre,
cherche dans l'espace la minceur des taches noires.
Tout s'est endormi. Dorment les livres en lourdes rangées.
Dorment tous les discours et toute leur vérité.
Dorment les chaînes et sourdement tintent leurs maillons.
Tous dorment pesamment : les saints, le Diable, Dieu.
Leurs valets perfides, leurs amis, leurs enfants.
La neige seule chuchote dans la nuit des chemins
et nul autre bruit ne traverse l'espace.
Mais quoi ! Écoute ! Dans les ténèbres glacées,
Là-bas quelqu'un pleure et murmure de peur,
Là-bas, prisonnier de l'hiver quelqu'un
pleure. Quelqu'un vit là-bas dans la nuit.
Une voix si fine. Fine comme une aiguille
sans fil... Une voix qui vogue solitaire
dans la neige, au creux du froid et de la brume,
cousant l'aube avec la nuit. Près du ciel.
Qui sanglote là-haut ? "Est-ce toi, mon ange
qui attends sous la neige comme l'été le retour
de mon amour ? Dans les ténèbres, tu rentres chez toi ?
Est-ce toi qui cries dans la nuit ? " — Pas de réponse.
"Est-ce vous, chérubins ? Le murmure de ces larmes
me rappelle votre chœur mélancolique.
Est-ce vous qui avez décidé soudain de quitter
ma cathédrale endormie ? Est-ce vous ? Est-ce vous ? "
Silence. "Est-ce toi, Paul ? Ta voix est si rauque
maintenant, après tous ces discours.
Est-ce toi qui baisses dans l'ombre ton front gris
et qui pleures ? " Le silence vole seul à ma rencontre.
"La main qui clôt les regards dans l'ombre
n'est-ce pas la main qui mène toute chose ?
Est-ce toi, Seigneur ? Mon esprit s'épuise,
mais la voix qui pleure est trop haute. "
Le silence s'ajoute au silence. "Est-ce toi, Gabriel,
qui souffles dans ta trompette au milieu des aboiements ?
Seul je viens à peine d'ouvrir mes yeux
et les cavaliers sellent déjà leurs chevaux.
Tout dort pesamment enlacé dans l'obscurité profonde.
Déjà les meutes innombrables se ruent du haut du ciel.
Est-ce toi, Gabriel, qui sanglotes dans ta trompette,
dans les ténèbres solitaires de l'hiver ?"
Non, c'est moi, ton âme, John Donne.
Je suis seule ici sous le ciel et je souffre
d'avoir créé par ma peine inlassable
des sentiments et des pensées lourds comme des chaînes.
Tu aurais pu t'envoler, chargé de ce fardeau,
jusqu'aux passions, jusqu'aux péchés, plus haut encore.
Tu étais un oiseau et tu as vu ton peuple entier
voler jusqu'à l'horizon sur le versant des toits.
Tu as vu toutes les mers et tous les pays lointains.
Tu as vu l'enfer en toi et chez les hommes.
Et tu as vu devant toi le paradis transparent
enchâssé dans la ronde triste des passions.
Tu l'as vu : la vie ressemble à une île.
Et tu parlais sans cesse avec cet Océan.
Le monde n'est que ténèbres et noirs hurlements.
Tu as volé autour de Dieu, tu as pris ton élan,
mais tu es trop lourd pour monter jusqu'au ciel
d'où notre monde n'est qu'une poussière de tours,
un long ruban de fleuves, et d'où le jugement dernier
n'apparaît plus le jugement terrible.
Là-bas l'espace entier n'est qu'immobilité,
là-bas tout paraît un songe malade et morbide,
là-bas Dieu n'est plus qu'une lumière à la fenêtre
par une nuit de brume, dans la maison la plus lointaine.
Aucune charrue n'y laboure les champs,
aucune charrue n'y laboure les années et les siècles.
Le mur infini des forêts entoure le pays
et dans les herbes hautes la pluie solitaire danse.
Le premier bûcheron qui poussera son cheval maigre
pour traverser à l'abandon l'effroi des fourrés
verra, s'il grimpe sur un pin, une flamme
qui luit au plus profond de la vallée.
Tout ce pays confus s'échappe à l'horizon.
Le regard tranquille glisse sur les toits incertains.
Il fait si clair ici. Les chiens cessent d'aboyer,
et les cloches cessent de sonner.
Il comprendra que tout se perd à l'infini, et tournera
son cheval vers la forêt d'un geste brutal.
Aussitôt les rênes, le traîneau, la nuit, lui-même
et le cheval maigre s'effaceront en un songe biblique.
Mais voilà, je pleure, je pleure. Il n'y a pas d'issue.
Il faut que je retourne au milieu de ces pierres.
Mais je ne peux partir dans mon habit de chair.
Je ne pourrai m'y envoler qu'à l'heure de la mort,
à cette heure unique après t'avoir oubliée, ma lumière,
à jamais, dans la terre humide, et me déchirera
le désir stérile de nager à ta rencontre
pour recoudre de ma chair notre séparation.
Mais quoi ? Pendant que mes larmes troublent ton repos
la neige dure vole à travers les ténèbres
et recoud dans sa fuite notre déchirement
et l'aiguille court, danse et s'élève.
Non, ce n'est pas moi qui sanglote, c'est toi qui pleures John Donne,
tu reposes solitaire et la vaisselle dort dans le buffet,
pendant que la neige tourbillonne sur la maison endormie,
pendant que la neige tourbillonne de l'horizon vers la nuit.
Pareil aux oiseaux, il dort dans son nid,
il a confié son chemin vers le bonheur
à l'étoile qui se cache au creux des nuages,
comme les oiseaux. Son âme est pure
mais son chemin dans le monde est rocailleux,
il est plus véridique que le nid de corbeau
au-dessus de la foule grise et vaine des étourneaux.
Comme les oiseaux, il s'éveillera au début du jour,
mais il repose maintenant sous un voile blanc,
pendant que le sommeil et la neige cousent
l'espace entre son âme et son corps endormi.
Tout dort. Mais deux ou trois vers attendent
encore leur dernier pied, et ricanent.
L'amour profane n'est qu'un fardeau du poète,
l'amour sacré n'est que la chair du prêtre.
Quelle que soit la roue que la rivière entraîne
elle moud toujours au monde le même pain :
si nous pouvons partager notre vie,
qui donc prendra sa part de notre mort ?
Un trou déchire l'étoffe et le premier venu
l'arrache à tous les bouts, part et revient.
Encore un coup ! Parfois l'horizon seul
prend dans la nuit l'aiguille du tailleur.
Dors John Donne, dors. Dors sans torturer ton âme.
Ton caftan s'étoile de trous et pend, désolé.
Regarde-le et tu verras se lever l'étoile
depuis toujours gardienne de ton repos.
Joseph Brodsky, Collines et autres poèmes (1966) Traduit du russe par Jean-Jacques Marie. Editions du Seuil 1987.