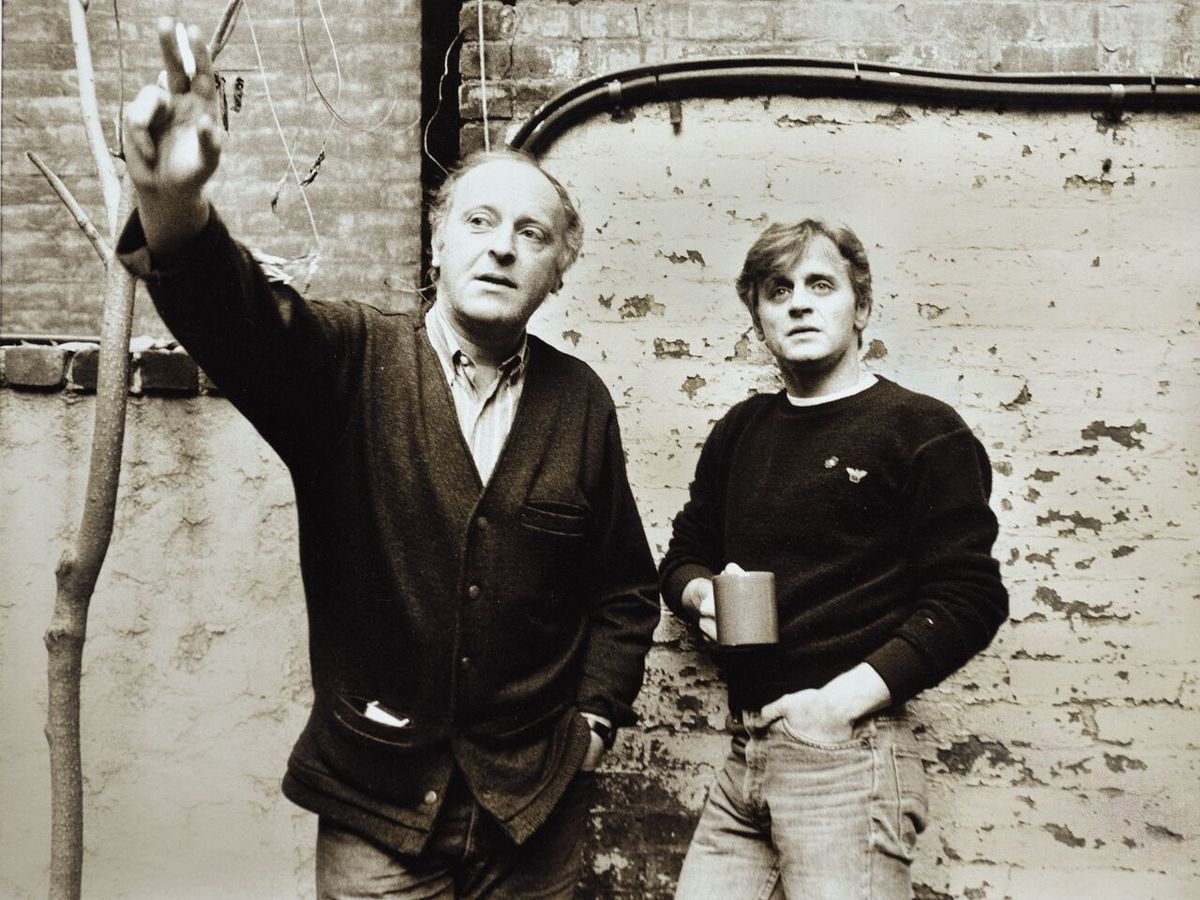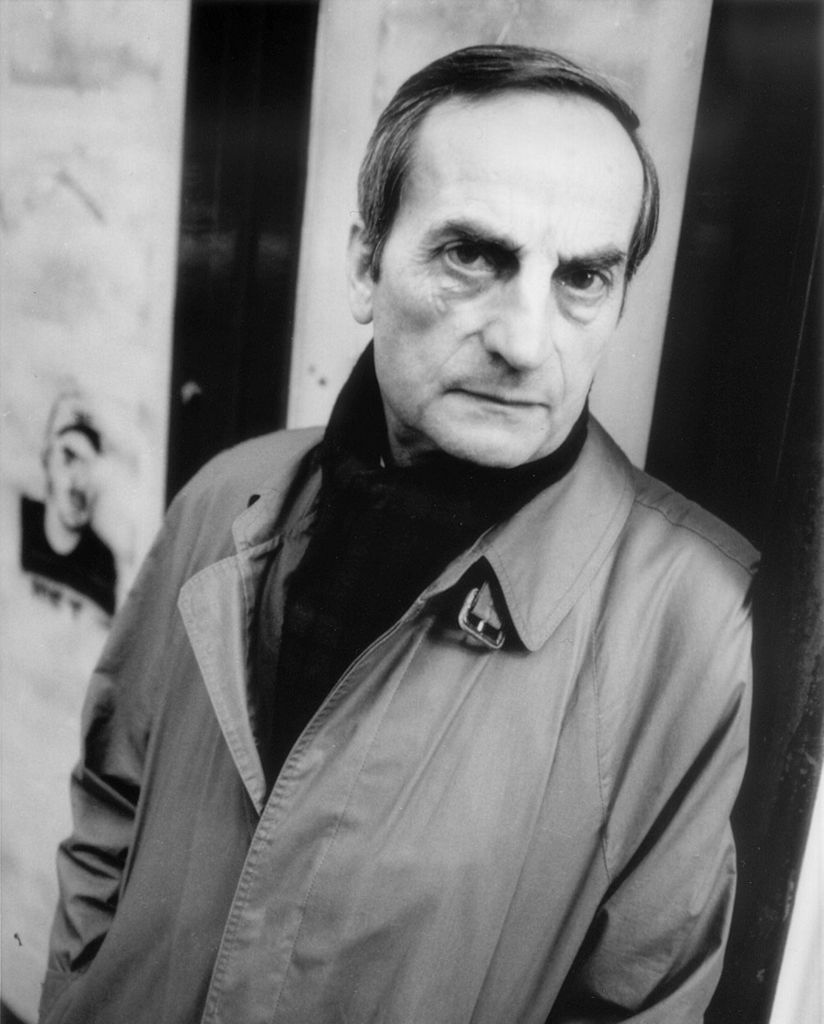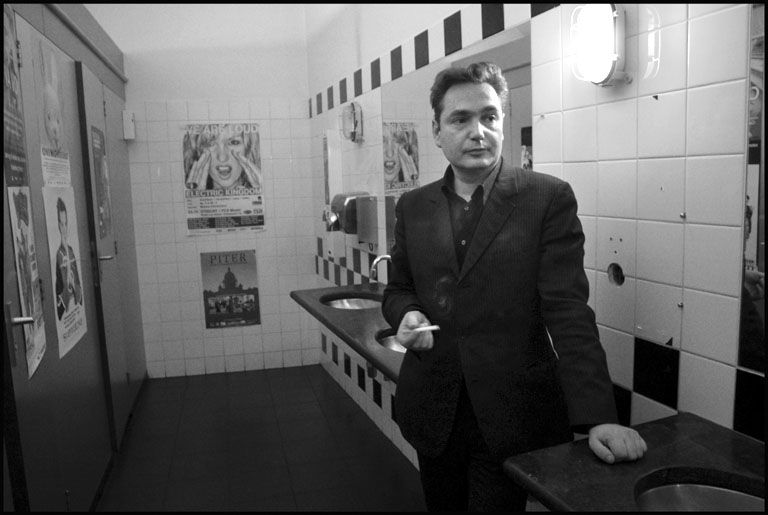Abattage

Sur la photo : Julio Cortázar et sa compagne Carol Dunlop
"Tout vers devrait avoir deux devoirs : communiquer un fait précis et nous atteindre physiquement comme la proximité de la mer." Jorge Luis Borges

Sur la photo : Julio Cortázar et sa compagne Carol Dunlop

Je n’ai jamais connu personne qui se soit fait rosser.
Tous ceux que je connais ont été champions en toute chose.
Et moi, si souvent bas, si souvent porc, si souvent vil,
moi, tant de fois si inexorablement parasite,
inexcusablement sale,
moi, qui tant de fois n’ai pas eu la patience de prendre un bain,
moi, qui tant de fois ai été ridicule, absurde,
qui me suis tant de fois entortillé les pieds dans les tapis de l’étiquette ;
qui ai été grotesque, mesquin, soumis et arrogant,
qui ai subi des affronts et me suis tu,
qui, lorsque je ne me suis pas tu, ai été encore plus ridicule ;
moi, dont les bonnes d’hôtel se sont gaussées ;
moi, qui ai senti les clignements d’yeux des portefaix,
moi, qui me suis adonné à de basses manœuvres financières, qui ai emprunté sans rembourser,
moi qui, venue l’heure du coup de poing, ai esquivé
toute possibilité de coup de poing ;
moi, qui ai souffert l’angoisse des petites choses ridicules,
je constate qu’en tout cela je n’ai pas de pair en ce monde.
Tous les gens que je connais et qui m’adressent la parole
n’ont jamais commis un acte ridicule, n’ont jamais subi d’affront,
n’ont été que des princes — princes tous et chacun — dans la vie…
Que ne puis-je entendre de quelqu’un la voix humaine
confesser, non un péché, mais une infamie ;
conter, non une violence, mais une lâcheté !
Non, ils sont tous l’Idéal, à les entendre me parler.
Qui y a-t-il en ce vaste monde qui m’avoue avoir été vil une fois ?
Ô princes, mes frères,
j’en ai par-dessus la tête de demi-dieux !
Où donc y a-t-il des gens moyens en ce monde ?
Je suis donc seul à être vil et dans l’erreur sur cette terre ?
Les femmes auront pu ne pas les aimer,
ils auront pu être trahis — mais ridicules, jamais !
Et moi, qui ai été ridicule sans avoir été trahi,
comment saurais-je parler à mes supérieurs sans bégayer ?
Moi qui ai été vil, littéralement vil,
vil au sens mesquin et infâme de la vilenie.
Fernando Pessoa, Poésies d’Alvaro de Campostraduit du portugais par Armand Guibert. Editions Gallimard 1968



Déjà plus
déjà pas
nous ne vivrons pas ensemble
je n'élèverai pas ton enfant
ne coudrai pas tes vêtements
ne te possèderai pas la nuit
ne t'embrasserai pas en partant
tu ne sauras jamais qui j'étais
pourquoi d'autres m'aimeront.
Je ne réussirai pas à savoir
pourquoi ni comment jamais
ni si c'était pour de vrai
ce que tu disais qu'il y avait
ni qui tu étais
ni ce que j'étais pour toi
ni comment cela aurait été
de vivre ensemble
de nous aimer
de nous attendre
d'être.
Désormais je ne suis plus que moi
pour toujours et toi
désormais
tu ne seras pour moi
pas plus que toi. Déjà tu n'es plus
d'un jour à venir
je ne saurais pas où tu vis
avec qui
ni si tu te souviens.
Tu ne m'embrasseras plus
comme cette nuit
jamais.
je ne reviendrai pas te toucher.
Je ne te verrai pas mourir.
*
Ya no será
Ya no
no viviremos juntos
no criaré a tu hijo
no coseré tu ropa
no te tendré de noche
no te besaré al irme
nunca sabrás quién fui
por qué me amaron otros.
No llegaré a saber
por qué ni cómo nunca
ni si era de verdad
lo que dijiste que era
ni quién fuiste
ni qué fui para ti
ni cómo hubiera sido
vivir juntos
querernos
esperarnos
estar.
Ya no soy más que yo
para siempre y tú
ya
no serás para mí
más que tú. Ya no estás
en un día futuro
no sabré donde vives
con quién
ni si te acuerdas.
No me abrazarás nunca
como esa noche
nunca.
No volveré a tocarte.
No té veré a morir.
(1958)
Idea Vilariño, Ultime Anthologie. traduction de l'espagnol (Uruguay) et postface par Eric Sarner. Avant-propos, Olivier galon. Editions La Barque 2017
Photo : Michel Sïma